Craig Johnson, trad. de l'anglais
Gallmeister, 356 pages, 23.80€
 À vol d'oiseau, le nouveau volet des aventures du shérif Walt Longmire, est sans doute l'un des meilleurs de la série qui compte pourtant déjà quelques pépites telles que Little Bird, Enfants de poussière, Dark Horse ou encore Molosse. Nous retrouvons notre héros et son fidèle complice Henry Standing Bear en bien fâcheuse posture. Les deux hommes étaient chargé de la location d'un endroit pittoresque pour le mariage de Cady, la fille de Walt, qui aura lieu dans quelques jours. Seulement ils viennent d'apprendre que le lieu ne sera finalement pas disponible à la date prévue et n'osent pas affronter la colère de la future mariée. Ils se lancent alors dans la recherche d'un petit coin de paradis qui pourrait arranger leurs affaires. Mais lors de leur pérégrination dans la réserve indienne, ils assistent impuissants à la chute d'une femme du haut d'une falaise.
À vol d'oiseau, le nouveau volet des aventures du shérif Walt Longmire, est sans doute l'un des meilleurs de la série qui compte pourtant déjà quelques pépites telles que Little Bird, Enfants de poussière, Dark Horse ou encore Molosse. Nous retrouvons notre héros et son fidèle complice Henry Standing Bear en bien fâcheuse posture. Les deux hommes étaient chargé de la location d'un endroit pittoresque pour le mariage de Cady, la fille de Walt, qui aura lieu dans quelques jours. Seulement ils viennent d'apprendre que le lieu ne sera finalement pas disponible à la date prévue et n'osent pas affronter la colère de la future mariée. Ils se lancent alors dans la recherche d'un petit coin de paradis qui pourrait arranger leurs affaires. Mais lors de leur pérégrination dans la réserve indienne, ils assistent impuissants à la chute d'une femme du haut d'une falaise.
Accourus à son secours, ils ne peuvent que constater son décès mais sont aussitôt bouleversés par la découverte, non loin du corps de la jeune fille, d'un bébé miraculeusement indemne. Accident, suicide ou meurtre ? Le shérif se met tout de suite en quête d'indices, mais il n'est pas sur sa juridiction et doit remettre l'affaire entre les mains de la nouvelle chef de la police tribale, la très impétueuse Lolo Long. Walt sait qu'il devrait se conscacrer aux préparatifs du mariage de Cady mais son instinct de policier n'est jamais au repos et il ne peut s'empêcher de creuser quelques pistes. Qui pouvait en vouloir à cette jeune femme sans histoires au point de la pousser d'une falaise avec son bébé ? Un polar plein de rebondissements mais aussi plein de chaleur humaine et d'un brin de magie indienne.
Parker Bilal. Trad. de l'anglais
Seuil, 396 pages, 21.50€
 Dans Les écailles d'or nous avions fait la connaissance de Makana, ex-officier de la police soudanaise, exilé politique en Egypte, devenu détective privé. Le voilà aux prises avec une nouvelle enquête qui, sous des apparences anodines, se révélera bien délicate. "L'Ibis bleu", une agence de voyages du Caire, a reçu d'étranges lettres de menaces. Alors que l'industrie du tourisme est déjà bien à la peine en cette année 2001 et que l'Egypte connait des troubles politiques et religieux, le patron de cette petite agence commence à craindre pour la survie de son business.
Dans Les écailles d'or nous avions fait la connaissance de Makana, ex-officier de la police soudanaise, exilé politique en Egypte, devenu détective privé. Le voilà aux prises avec une nouvelle enquête qui, sous des apparences anodines, se révélera bien délicate. "L'Ibis bleu", une agence de voyages du Caire, a reçu d'étranges lettres de menaces. Alors que l'industrie du tourisme est déjà bien à la peine en cette année 2001 et que l'Egypte connait des troubles politiques et religieux, le patron de cette petite agence commence à craindre pour la survie de son business.
Makana accepte d'enquêter sur la provenance de ces lettres et découvre vite qu'elles visent en réalité une employée en particulier, Meera. La jeune femme qui se fait discrète ne s'intègre pas réellement au reste de l'équipe. Non seulement elle est copte mais c'est aussi la femme d'un universitaire musulman renvoyé pour ses opinions subversives sur le Coran et menacé par les intégristes dont l'influence ne cesse de croître dans tous les domaines. L'enquête s'annonce d'autant plus difficile que la petite communauté copte du Caire, déjà persécutée, est en proie à une vague de meurtres de jeunes garçons que les autorités égyptiennes veulent attribuer à des rituels obscurs pratiqués dans certaines églises du quartier.
Une situation complexe comme Makana les aime et nous aussi.
Carrie Snyder. Trad. de l'anglais
Gallimard, 350 pages, 22.50€
 Dans la maison de retraite où elle a été placée contre son gré, Aganetha Smart vit dans la solitude. À cent ans, c'est une vieille femme affaiblie qui ne voit ni n'entends plus très bien, qui n'a plus guère l'occasion de parler et que les infirmières déplacent dans son fauteuil roulant de sa chambre au réfectoire. De ses nombreux frères et soeurs il ne reste plus personne. Il n'y a plus personne non plus pour se souvenir de sa gloire passée, de son parcours d'exception, de sa vie faite de joies et de malheurs. Mais Aganetha, elle, se souvient de tout. Et lorsque deux jeunes visteurs viennent la chercher dans sa résidence pour l'emmener en promenade, elle se méfie mais se réjouit aussi de cette sortie inattendue. C'est l'occasion de revoir une dernière fois la ferme de ses parents où tant de drames se sont joués, c'est aussi une opportunité de raconter sa longue vie, son enfance heureuse dans la campagne canadienne, sa passion pour la course qui la mena loin de sa famille puis la désillusion et le dur revers de la médialle.
Dans la maison de retraite où elle a été placée contre son gré, Aganetha Smart vit dans la solitude. À cent ans, c'est une vieille femme affaiblie qui ne voit ni n'entends plus très bien, qui n'a plus guère l'occasion de parler et que les infirmières déplacent dans son fauteuil roulant de sa chambre au réfectoire. De ses nombreux frères et soeurs il ne reste plus personne. Il n'y a plus personne non plus pour se souvenir de sa gloire passée, de son parcours d'exception, de sa vie faite de joies et de malheurs. Mais Aganetha, elle, se souvient de tout. Et lorsque deux jeunes visteurs viennent la chercher dans sa résidence pour l'emmener en promenade, elle se méfie mais se réjouit aussi de cette sortie inattendue. C'est l'occasion de revoir une dernière fois la ferme de ses parents où tant de drames se sont joués, c'est aussi une opportunité de raconter sa longue vie, son enfance heureuse dans la campagne canadienne, sa passion pour la course qui la mena loin de sa famille puis la désillusion et le dur revers de la médialle.
Car ce qui fait d'Aganetha une femme d'exception c'est qu'elle fut médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 1928. Les Jeux d'Amsterdam sont les premiers à autoriser la présence d'équipes féminines d'athlétisme. Pendant deux ans la jeune femme va s'entraîner durement au côté de Glad, la sprinteuse, et des autres filles recrutées par Melle Gib, responsable de l'équipe du Canada. Sa passion dévorante pour la course à une époque où la pratique du sport par les femmes est vue d'un mauvaise oeil, où le simple fait de porter un short peut faire de vous une fille aux moeurs douteuses, où la jeune fille canadienne se doit surtout d'être une future bonne épouse, permettra à Aganetha de connaître l'amitié, l'amour, la notorieté mais tout cela sera de bien courte durée au regard des cent années de sa longue vie.
LAHIRE Bernard
Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse »
La Découverte, 2016, 182 pages, 15,70€
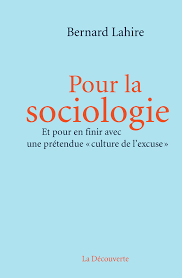
Accusée d’excuser, de justifier voire d’encourager les violences et délits, la sociologie est sans cesse délégitimée par des personnalités politiques ou médiatiques et la voix de ceux qui tentent de faire entendre raison résonne bien faiblement au milieu de ce vacarme. Dans cet essai court et percutant, le sociologue français Bernard Lahire retrace la généalogie des critiques à l’encontre de la discipline et démonte la rhétorique viciée de ses détracteurs.
Aux origines de cette défiance, Lahire pointe la « blessure narcissique » infligée par la sociologie à l’homme moderne, qui a « fait tomber l’illusion selon laquelle chaque individu serait un atome isolé, libre et maître de son destin, petit centre autonome d’une expérience du monde sans contraintes ni causes. » À force d’observation, de contextualisation et d’historisation, la sociologie met ainsi en lumière les déterminismes qui nous traversent tous. Il ne s’agit ici nullement de juger, mais de comprendre, au sens le plus strict, comme le rappelle Lahire qui récuse le parallèle le plus répandu : sociologie égale « science de l’excuse ».
À coup d’exemples et d’arguments, il dévoile comment la résistance à l’idée d’un déterminisme social s’avère être bien plus une volonté de garder dans l’ombre les forces et contre-forces à l’œuvre : dans une société qui voudrait nous faire croire à l’égalité des chances, le rappel des réalités socio-économiques, culturelles ou scolaires contredit les grands principes de méritocratie loués par les dominants de ce monde.
Mais en réhabilitant la sociologie, Bernard Lahire nous montre surtout quel formidable instrument de démocratie est à notre portée : bien au-delà des conclusions auxquelles elle parvient, la sociologie est avant tout un cheminement intellectuel qui permet un décentrement du soi ; qui offre l’occasion de déchiffrer le monde qui nous entoure pour devenir, enfin, « citoyens un peu plus sujets de [nos] actions, dans un monde social rendu un peu moins opaque, un peu moins étrange et un peu moins immaîtrisable ».