Benjamin Whitmer, trad. de l’américain
Gallmeister, 404 pages.
Les prisons sont là pour cacher que c’est le social tout entier dans son omniprésence banale, qui est carcéral. (Jean Baudrillard)
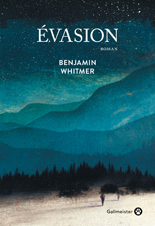 Dans une petite ville du Colorado proche de Denver et des Rocheuses, douze détenus de la prison d’Old Lonesome s’évadent. Commence alors une course poursuite effroyable qui secoue toute la ville : gardiens, journalistes, habitants, tout le monde se lance à la recherche des prisonniers sous un blizzard impitoyable. Le directeur de la prison et nombre des gardiens qu’il a recruté sont tous membres du Klu Klux Klan, des hommes d’une grande violence.
Dans une petite ville du Colorado proche de Denver et des Rocheuses, douze détenus de la prison d’Old Lonesome s’évadent. Commence alors une course poursuite effroyable qui secoue toute la ville : gardiens, journalistes, habitants, tout le monde se lance à la recherche des prisonniers sous un blizzard impitoyable. Le directeur de la prison et nombre des gardiens qu’il a recruté sont tous membres du Klu Klux Klan, des hommes d’une grande violence.
Plus qu’un roman noir, Évasion est une réflexion sur la violence sociale et sur la condition humaine. Peut-on échapper aux déterminismes sociaux et économiques?
La parole est à Benjamin Whitmer dans une interview avec François Busnel:
«La plupart de nos choix sont illusoires. (…) Nous sommes souvent déterminés par nos origines sociales. Là où vous étiez à votre naissance, là où vous serez à votre mort. (…) Dans ce pays en particulier, notre culture n’est pas vraiment celle de la compassion. Nous sommes très fort pour juger certaines personnes surtout les délinquants, les gens qui ont commis des fautes, fait des choses que nous considérons impardonnables, nous les excluons, alors mon but c’est toujours de choisir dans chaque livre des personnages qui n’attireront pas d’emblée le lecteur, qu’il n’arrivera pas à aimer mais j’espère l’amener à comprendre leurs choix et à se dire que peut-être il peut éprouver de la compassion pour ces personnes. [...] La prison c’est une métaphore de toute la société américaine. Nous vivons dans un pays qui proclame constamment ses idées de liberté. Mais nous n’y croyons pas vraiment sauf de façon immatérielle. Nous vivons dans un pays où il y a plus de gens en prison que partout ailleurs ce qui selon toute norme raisonnable nous désignerait comme le pays le moins libre du monde. [...] La violence c’est l’Amérique. Nous, nous exportons de la violence. Notre pays est bâti sur une extermination, le génocide du peuple amérindien qui vivait ici avant et l’esclavage. Nous avons toujours été une culture violente. Un des problèmes que j’ai avec le débat sur les armes, je sais que des gens meurent à cause des armes mais la plupart sont des suicides, 60% sont des suicides et on ne parle jamais de l’autre violence qui sévit en Amérique, la violence économique. Un quart des gens de ce pays se demande s’ils vont avoir à manger ce soir, des gens qui ne peuvent pas amener leurs enfants chez le médecin. Et pour moi ça c’est la vraie violence"
Évasion se conclut sur ces dernières lignes. Peu optimistes, elles restent toutefois à méditer : Parce qu’on survit. C’est tout ce qu’il y a. Il n’y a rien dans ce monde qui vaille qu’on vive pour lui, mais on le fait quand même. On n’y pense pas, on se contente d’avancer. On survit et on espère seulement qu’on pourra s’accrocher à un bout de soi-même qui vaille qu’on survive.
Valérie Manteau,
Le tripode, 262pages, 17€, Prix Renaudot 2018
 Dans Calme et tranquille (2016, éditions du Tripode), Valérie Manteau qui venait de s’expatrier à Marseille, nous racontait son expérience de la violence et de la mort. En effet elle devait faire face conjointement au suicide de sa grand-mère et à la mort de ses collègues et amis de Charlie Hebdo après l’attentat perpétué par les frères Kouachy.
Dans Calme et tranquille (2016, éditions du Tripode), Valérie Manteau qui venait de s’expatrier à Marseille, nous racontait son expérience de la violence et de la mort. En effet elle devait faire face conjointement au suicide de sa grand-mère et à la mort de ses collègues et amis de Charlie Hebdo après l’attentat perpétué par les frères Kouachy.
Dans Le sillon, la journaliste est partie s’installer à Istanbul. Elle y a rejoint un amant turc et peine à écrire un roman. Elle est impliquée dans la vie culturelle et intellectuelle locale, y fréquente entre autres Asli Erdogan.
Elle retrouve son énergie et sa hargne lorsqu’elle décide d’écrire sur Hrant Dink, un journaliste turco-arménien abattu en pleine rue, à Istanbul en 2007, devant le siège de son journal, Agos.
Entre récit d’une errance stambouliote et dénonciation des crimes féroces perpétués par le président turc Recep Tayyip Erdogan afin de museler les intellectuels de son pays, Valérie Manteau creuse son sillon d’une rive à l’autre du Bosphore et nous livre avec maestria les tribulations intranquilles de cette ville aux multiples visages où nombreux sont ceux qui se battent pour la liberté.
Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d’adolescents aux yeux brillants qui surgissent au coin de la rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines funambules aux pieds cisaillés, je rêve que je marche sur les tuiles des toits d’Istanbul et qu’elles glissent et se décrochent. Mais toujours ta main me rattrape, juste au moment où je me réveille en plein vertige, les poings fermés, agrippée aux draps ; même si de plus en plus souvent au réveil tu n’es plus là.
Le sillon, un livre à la démarche « d’autofiction documentaire » comme Valérie Manteau la définit elle-même à lire absolument!
François Roux
Albin Michel, 265 pages, 22€25
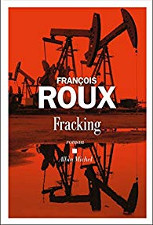 Ses études à l'université de Chicago terminées, Lisa retourne chez ses parents, éleveurs de bovins dans le Dakota du Nord. Cela fait quatre ans qu'elle n'a pas revu sa mère, Karen, avec laquelle elle entretient depuis toujours une relation assez houleuse qui s'est encore déteriorée après le décès de son frère Matt, il y a 6 ans. Lisa découvre que ses parents sont à bout de nerfs. Déjà éprouvés par la perte de leur fils, ils doivent faire face à la situation catastrophique de leur exploitation. Depuis quelques années, leurs terres sont entourées de forages pétroliers. Le bruit incessant, les flammes brûlant sans discontinuer au sommet des plateformes, les camions roulant à toute vitesse ont rendu leur quotidien insupportable, sans parler des nuisances invisibles qui polluent leurs terres. Lisa retrouve aussi les anciens amis de son frère : Joe, devenu un employé de la firme pétrolière qui exploite les gisements sous le terrain de sa famille, et Ross le fils de leurs anciens voisins dont les parents ont vendu les droits d'exploitation de leur sol pour une petite fortune. Elle fait aussi la connaissance de Steven, un activiste écologiste qui se bat contre le passage d'un oléoduc sur des terres appartenant à une réserve indienne. Entre ceux qui tentent à tout prix de préserver la nature et ceux qui se sont laissés convaincre par les géants de l'industrie, rien n'est simple. Un roman captivant et éclairant sur l'Amérique contemporaine.
Ses études à l'université de Chicago terminées, Lisa retourne chez ses parents, éleveurs de bovins dans le Dakota du Nord. Cela fait quatre ans qu'elle n'a pas revu sa mère, Karen, avec laquelle elle entretient depuis toujours une relation assez houleuse qui s'est encore déteriorée après le décès de son frère Matt, il y a 6 ans. Lisa découvre que ses parents sont à bout de nerfs. Déjà éprouvés par la perte de leur fils, ils doivent faire face à la situation catastrophique de leur exploitation. Depuis quelques années, leurs terres sont entourées de forages pétroliers. Le bruit incessant, les flammes brûlant sans discontinuer au sommet des plateformes, les camions roulant à toute vitesse ont rendu leur quotidien insupportable, sans parler des nuisances invisibles qui polluent leurs terres. Lisa retrouve aussi les anciens amis de son frère : Joe, devenu un employé de la firme pétrolière qui exploite les gisements sous le terrain de sa famille, et Ross le fils de leurs anciens voisins dont les parents ont vendu les droits d'exploitation de leur sol pour une petite fortune. Elle fait aussi la connaissance de Steven, un activiste écologiste qui se bat contre le passage d'un oléoduc sur des terres appartenant à une réserve indienne. Entre ceux qui tentent à tout prix de préserver la nature et ceux qui se sont laissés convaincre par les géants de l'industrie, rien n'est simple. Un roman captivant et éclairant sur l'Amérique contemporaine.
Léa Carpenter, trad. de l'anglais
Gallmeister, 272 pages, 22€
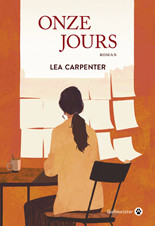 Sara vit seule, en Pennsylvanie, dans la maison où elle a élevé son fils, Jason, aujourd'hui un jeune homme de 27 ans. C'est seule aussi qu'elle a toujours pris soin de lui. Une grossesse inattendue, elle trop jeune, le père bien plus vieux, pris par un boulot exigeant qui lui coûtera la vie alors que Jason n'a que 8 ans. C'est seule toujours qu'elle part courir sur les chemins pour évacuer l'angoisse et se vider la tête. Sara est donc seule, en ce jour de mai 2011 lorsque deux officiers de l'armée viennent se présentent à sa porte. Jason fait partie des SEAL, l'élite des forces spéciales américaines. Depuis qu'il s'est engagé, à 17 ans, après les terribles images des attentats du 11 septembre 2001, Sara a peur pour son fils. Aujourd'hui ce qu'elle redoutait le plus est arrivé. Jason a disparu. Est-il sain et sauf, réfugié quelque part, blessé, incapable de rejoindre son unité ou pire encore ? Pendant onze jours, Sara va attendre des nouvelles de son fils. Pendant onze jours, elle va relire les lettres et les mails que Jason lui a envoyés durant ses années de formation, elle va essayer de comprendre sa volonté de s'engager. Mais on va aussi entendre la voix de Jason, tout ce qu'il ne dit pas à sa mère, la difficulté de la formation, les camps d'entraînements, les opérations. L'on est bouleversé par l'amour de cette mère pour son fils et troublé par la force de l'engagement du jeune homme.
Sara vit seule, en Pennsylvanie, dans la maison où elle a élevé son fils, Jason, aujourd'hui un jeune homme de 27 ans. C'est seule aussi qu'elle a toujours pris soin de lui. Une grossesse inattendue, elle trop jeune, le père bien plus vieux, pris par un boulot exigeant qui lui coûtera la vie alors que Jason n'a que 8 ans. C'est seule toujours qu'elle part courir sur les chemins pour évacuer l'angoisse et se vider la tête. Sara est donc seule, en ce jour de mai 2011 lorsque deux officiers de l'armée viennent se présentent à sa porte. Jason fait partie des SEAL, l'élite des forces spéciales américaines. Depuis qu'il s'est engagé, à 17 ans, après les terribles images des attentats du 11 septembre 2001, Sara a peur pour son fils. Aujourd'hui ce qu'elle redoutait le plus est arrivé. Jason a disparu. Est-il sain et sauf, réfugié quelque part, blessé, incapable de rejoindre son unité ou pire encore ? Pendant onze jours, Sara va attendre des nouvelles de son fils. Pendant onze jours, elle va relire les lettres et les mails que Jason lui a envoyés durant ses années de formation, elle va essayer de comprendre sa volonté de s'engager. Mais on va aussi entendre la voix de Jason, tout ce qu'il ne dit pas à sa mère, la difficulté de la formation, les camps d'entraînements, les opérations. L'on est bouleversé par l'amour de cette mère pour son fils et troublé par la force de l'engagement du jeune homme.