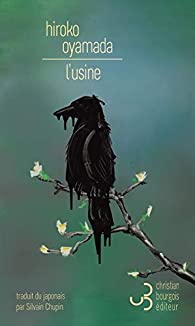 "Au contraire, quand une machine devient inutilisable et que je décide immédiatement de l éteindre pour passer à une autre, je me sens comme un membre à part entière de la société, qui fait un choix dans son travail. Seulement, bien sûr, ce sentiment ne dure pas. Dès le deuxième jour, mon travail n'a plus de secret pour moi et, hormis dysfonctionnement important, je n'ai plus besoin d'utiliser un neurone."
"Au contraire, quand une machine devient inutilisable et que je décide immédiatement de l éteindre pour passer à une autre, je me sens comme un membre à part entière de la société, qui fait un choix dans son travail. Seulement, bien sûr, ce sentiment ne dure pas. Dès le deuxième jour, mon travail n'a plus de secret pour moi et, hormis dysfonctionnement important, je n'ai plus besoin d'utiliser un neurone."
Le premier roman d'Hiroko Oyamada traduit en français se déroule dans une usine immense, qu'on dira "générique" - l'autrice ne donnera aucune information sur ce qui y est produit -. Trois employés récemment engagés y expérimentent la vanité, l'absurdité et l'effarement d'un travail inutile. Cet effroyable portrait de l'aliénation au travail nous laisse presque sans voix, un sentiment de reddition dans l'air. Mais, en contrepoint total et dans un réflexe de survie, il nous incite à réintégrer la notion de "sens" au fond de nos actes et pensées.
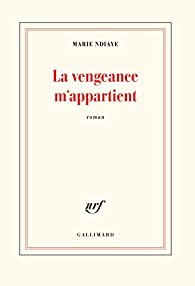 Lorsque Gilles Principaux pénètre dans le bureau de l'avocate Me Susane c'est comme "un coup violent porté à son front".
Lorsque Gilles Principaux pénètre dans le bureau de l'avocate Me Susane c'est comme "un coup violent porté à son front".
Me Susane a le sentiment de connaître ce Gilles Pricipaux. N'est-ce pas cet adolescent qui trente ans plus tôt l'a emmenée dans sa chambre alors qu'elle accompagnait sa mère, femme de ménage, dans cette maison cossue ? Cet après-midi-là est resté gravé à tout jamais dans sa mémoire comme le jour où un monde de possibles lui est apparu : possible de sortir de sa condition sociale, possible d'être une autre et pas juste cette adolescente aux traits ingrats et trop grosse...
Mais Gilles Principaux, lui, ne la reconnaît pas, et il n'accorde d'ailleurs aucune importance à cela. Lui, il est là pour une chose qui lui tient bien plus à coeur. Il demande à Me Susane de défendre sa femme Marlyne, une femme aimante et dévouée, une mère fabuleuse, une femme qui pourtant a posé un acte terrifiant : un après-midi elle a noyé leurs trois enfants dans la baignoire de leur maison.
Me Susane accepte cette défense bien qu'elle est fort troublée par la personnalité, l'attitude et les motivations de Gilles Principaux. Elle n'en sera pas moins troublée par les révélations de Marlyne qu'elle va visiter en prison, l'occasion d'un monologue extraordinaire, hallucinant et halluciné, sur une dizaine de pages où Marlyne tente d'expliquer son geste. Son trouble ne fera que s'accentuer lorsque Sharon, sa femme de ménage, cette personne parfaite, charmante et de confiance se révèlera être bien plus secrète et complexe qu'il n'y parait.
Dans La vengeance m'appartient, le lecteur ne quitte pas un seul instant l'esprit de Me Susane même si le livre se construit autour de trois femmes, trois femmes complexes, troubles, opaques.
Avec La vengeance m'appartient, l'écrivaine Marie Ndiaye signe un livre époustouflant tant sur le plan littéraire que sur les réflexions et sentiments qu'il provoque chez son.sa lecteur.trice : il n'y a de vérités que relatives, les hommes ne sont pas ce qu'ils semblent être, nous ne pouvons faire confiance ni à nos perceptions ni à notre mémoire...
Vous l'aurez compris dans le livre de Marie Ndiaye on ne trouve ni certitudes, ni solutions, ni résolutions. On avance en terrain glissant, mouvant, un terrain qui se dérobe sous nos pieds où toute tentative d'ancrage est vaine, où tout est noyé dans le brouillard, où tout reste dans l'opacité.
Livre oppressant, étouffant même, La vengeance m'appartient est un grand livre.
 Division avenue, c'est cette rue de Brooklyn, coeur du quartier juif hassidique. C'est là que vit Surie Eckstein, mère accomplie, fière de sa progéniture, grand-mère heureuse. Mais voilà, alors qu'elle ne pensait plus ça possible, Surie se retrouve enceinte à un âge très avancé. Choquée, elle qui a toujours aimé avoir et élever de nombreux enfants, elle n'arrive pas à se réjouir ni à annoncer la nouvelle à son mari et à son entourage. Ce secret qu'elle garde, elle l'associe bientôt à celui qu'a dû taire aussi son fils Lipa.
Division avenue, c'est cette rue de Brooklyn, coeur du quartier juif hassidique. C'est là que vit Surie Eckstein, mère accomplie, fière de sa progéniture, grand-mère heureuse. Mais voilà, alors qu'elle ne pensait plus ça possible, Surie se retrouve enceinte à un âge très avancé. Choquée, elle qui a toujours aimé avoir et élever de nombreux enfants, elle n'arrive pas à se réjouir ni à annoncer la nouvelle à son mari et à son entourage. Ce secret qu'elle garde, elle l'associe bientôt à celui qu'a dû taire aussi son fils Lipa.
Surie est un magnifique personnage, qui cherche à trouver le juste chemin entre sa vérité intérieure et le respect des règles de sa communauté, une émancipation qui, pour insignifiante qu'elle puisse paraître pour certains, n'en constitue pas moins pour elle une révolution.
 On se souvient de Sandro Veronesi et de son Chaos calme paru il y a une quinzaine d'années, magnifique livre sur le deuil. Il vient de remporter pour la seconde fois le prix Strega avec Le Colibri. C'est ainsi que dans sa jeunesse on surnommait Marco Carrera, héros et narrateur de ce nouveau roman, à cause de sa petite taille. Aujourd'hui plus grand, devenu ophtalmologiste reconnu, ce surnom continue à lui correspondre : comme l'oiseau, il s'évertue à rester immobile alors qu'autour de lui tout change. Malgré les coups du sort qui le frappent plusieurs fois, malgré un amour absolu qui pourrait lui faire perdre pied, il concentre toute son énergie à tenir bon en restant lui-même.
On se souvient de Sandro Veronesi et de son Chaos calme paru il y a une quinzaine d'années, magnifique livre sur le deuil. Il vient de remporter pour la seconde fois le prix Strega avec Le Colibri. C'est ainsi que dans sa jeunesse on surnommait Marco Carrera, héros et narrateur de ce nouveau roman, à cause de sa petite taille. Aujourd'hui plus grand, devenu ophtalmologiste reconnu, ce surnom continue à lui correspondre : comme l'oiseau, il s'évertue à rester immobile alors qu'autour de lui tout change. Malgré les coups du sort qui le frappent plusieurs fois, malgré un amour absolu qui pourrait lui faire perdre pied, il concentre toute son énergie à tenir bon en restant lui-même.
Un roman vibrant, doux et déchirant, sur la douleur, la perte, l'acceptation, la mort mais surtout la vie, envers et malgré tout.