Collectif
Somogy, 447 pages, 39€
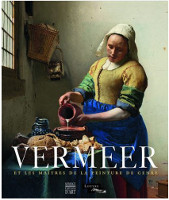 Vermeer, ou « le sphinx de Delft ». Cette expression, forgée au XIXe siècle, a figé la personnalité de Johannes Vermeer (1632-1675) dans une pose énigmatique et solitaire. Cet ouvrage original permet au contraire de découvrir que ce génie universel s'inscrivait dans un riche réseau d'influences, très loin du splendide isolement avec lequel il fut longtemps associé.
Vermeer, ou « le sphinx de Delft ». Cette expression, forgée au XIXe siècle, a figé la personnalité de Johannes Vermeer (1632-1675) dans une pose énigmatique et solitaire. Cet ouvrage original permet au contraire de découvrir que ce génie universel s'inscrivait dans un riche réseau d'influences, très loin du splendide isolement avec lequel il fut longtemps associé.
La scène de genre élégante hollandaise connaît son âge d'or vers 1650-1680. Cette peinture, mise en scène luxueuse d'activités qui n'ont de quotidiennes que le nom, permet à la République des Provinces-Unies de s'affirmer face aux monarchies. Vermeer en est l'un des maîtres, aux côtés de Gérard Dou, Gérard ter Borch, Frans van Mieris, Gabriel Metsu, Pieter de Hooch... Ces peintres, actifs à Leyde, Deventer, Amsterdam ou Delft, ont eu connaissance du travail des uns et des autres. Leurs rapports alternent hommages, citations détournées, métamorphoses.
Vues de la sorte, les sublimations de Vermeer prennent un sens nouveau : celui de ses rejets et de ses admirations.
Notice de l'éditeur
James Barr, trad. de l'anglais
Perrin, 510 pages, 28,40€
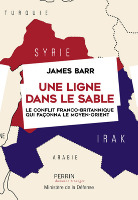 Comment la France et la Grande-Bretagne se sont-elles partagé le Moyen-Orient ? À travers une analyse novatrice, James Barr montre que, des accords Sykes-Picot, en 1916, à 1948, tout a été mis en place pour dynamiter la région : la Syrie à feu et à sang, la montée des extrêmes terroristes, le statut de Jérusalem et la maîtrise du canal de Suez en ont tour à tour été les détonateurs. Telles sont les répercussions d'un long face-à-face entre Londres et Paris dont la rivalité se cristallise autour de la question juive. D'un côté, les Anglais ont recouru aux sionistes pour contrecarrer les ambitions françaises au Moyen-Orient, conduisant ainsi à une escalade tragique de la tension entre Arabes et Juifs. De l'autre, les Français ont joué un rôle décisif dans la création de l'État d'Israël. Ils contribuèrent à organiser une immigration à grande échelle et une subversion violente et dévastatrice qui, en 1948, finit par engloutir un mandat britannique en déconfiture. Revenant sur le duel aussi venimeux que mal connu entre la Grande-Bretagne et la France, ce récit écrit d'une plume fluide s'attache aux protagonistes du conflit - politiques, diplomates, espions et soldats - et éclaire les problématiques passées et actuelles du Moyen-Orient.
Comment la France et la Grande-Bretagne se sont-elles partagé le Moyen-Orient ? À travers une analyse novatrice, James Barr montre que, des accords Sykes-Picot, en 1916, à 1948, tout a été mis en place pour dynamiter la région : la Syrie à feu et à sang, la montée des extrêmes terroristes, le statut de Jérusalem et la maîtrise du canal de Suez en ont tour à tour été les détonateurs. Telles sont les répercussions d'un long face-à-face entre Londres et Paris dont la rivalité se cristallise autour de la question juive. D'un côté, les Anglais ont recouru aux sionistes pour contrecarrer les ambitions françaises au Moyen-Orient, conduisant ainsi à une escalade tragique de la tension entre Arabes et Juifs. De l'autre, les Français ont joué un rôle décisif dans la création de l'État d'Israël. Ils contribuèrent à organiser une immigration à grande échelle et une subversion violente et dévastatrice qui, en 1948, finit par engloutir un mandat britannique en déconfiture. Revenant sur le duel aussi venimeux que mal connu entre la Grande-Bretagne et la France, ce récit écrit d'une plume fluide s'attache aux protagonistes du conflit - politiques, diplomates, espions et soldats - et éclaire les problématiques passées et actuelles du Moyen-Orient.
Notice de l'éditeur
Jessie Burton. Trad. de l'anglais
Gallimard, 496 pages, 22.50€
 Nous avions découvert le talent de Jessie Burton avec Miniaturiste (paru chez Gallimard en 2015 et désormais disponible en Folio) et attendions avec impatience son second roman! Le voici donc et c'est une réussite ! L'histoire se déroule sur deux époques et dans deux lieux différents. D'abord, l'Andalousie dans les années trente. La famille Schloss a quitté Londres pour s'intaller dans une villa du sud de l'Espagne espérant que le climat méditerranéen sera bénéfique à Sarah, la mère, qui souffre de dépression. Olive, la fille de la famille, a suivi ses parents dans leur exil. Elle y fait la connaissance de Teresa et Isaac, qui travaillent sur la propriété. L'Espagne vit des heures troubles et Isaac, très impliqué dans la lutte révolutionnaire, bouscule la tranquilité de la villa même si les Schloss, centrés sur leurs problèmes personnels ne prennent pas la mesure des bouleversements qui secouent la région. Ensuite, la ville de Londres à la fin des années 60. Odelle a quitté les Caraïbes pour tenter sa chance dans la capitale britannique. Après quelques années de galère, la jeune femme qui se rêve écrivain, a enfin décroché un job intéressant dans une galerie d'art. Elle y fait la connaissance de Quick, une femme un peu extravagante qui la pousse à réaliser ses rêves et lui ouvre les portes de sa maison. Elle rencontre aussi l'amour en la personne de Lawrie Scott, un jeune homme un peu perdu suite au décès de sa mère. Celle-ci ne lui a rien laissé si ce n'est un tableau Les filles au Lion qu'Odele montre à Quick. Sa patronne est bouleversée par l'oeuvre, pas seulement par sa beauté mais aussi par le fait que ce tableau réapparaisse près de 30 ans après avoir été vu pour la dernière fois en Andalousie. Qui est Robles, le mystérieux peintre, auteur de ce chef-d'oeuvre ? Comment la mère de Lawrie l'a-t-elle acquis ? Pourquoi Quick est-elle déstabilisée par la toile ?
Nous avions découvert le talent de Jessie Burton avec Miniaturiste (paru chez Gallimard en 2015 et désormais disponible en Folio) et attendions avec impatience son second roman! Le voici donc et c'est une réussite ! L'histoire se déroule sur deux époques et dans deux lieux différents. D'abord, l'Andalousie dans les années trente. La famille Schloss a quitté Londres pour s'intaller dans une villa du sud de l'Espagne espérant que le climat méditerranéen sera bénéfique à Sarah, la mère, qui souffre de dépression. Olive, la fille de la famille, a suivi ses parents dans leur exil. Elle y fait la connaissance de Teresa et Isaac, qui travaillent sur la propriété. L'Espagne vit des heures troubles et Isaac, très impliqué dans la lutte révolutionnaire, bouscule la tranquilité de la villa même si les Schloss, centrés sur leurs problèmes personnels ne prennent pas la mesure des bouleversements qui secouent la région. Ensuite, la ville de Londres à la fin des années 60. Odelle a quitté les Caraïbes pour tenter sa chance dans la capitale britannique. Après quelques années de galère, la jeune femme qui se rêve écrivain, a enfin décroché un job intéressant dans une galerie d'art. Elle y fait la connaissance de Quick, une femme un peu extravagante qui la pousse à réaliser ses rêves et lui ouvre les portes de sa maison. Elle rencontre aussi l'amour en la personne de Lawrie Scott, un jeune homme un peu perdu suite au décès de sa mère. Celle-ci ne lui a rien laissé si ce n'est un tableau Les filles au Lion qu'Odele montre à Quick. Sa patronne est bouleversée par l'oeuvre, pas seulement par sa beauté mais aussi par le fait que ce tableau réapparaisse près de 30 ans après avoir été vu pour la dernière fois en Andalousie. Qui est Robles, le mystérieux peintre, auteur de ce chef-d'oeuvre ? Comment la mère de Lawrie l'a-t-elle acquis ? Pourquoi Quick est-elle déstabilisée par la toile ?
Valerio Varesi. Trad. de l'italien
Agullo, 313 pages, 24.40€
 La pension de la via Saffi est un roman policier avec un commissaire, un crime, des suspects... Mais c'est avant tout un magnifique roman d'ambiance au coeur d'un quartier populaire de Parme. Tout commence quelques jours avant Noël. Le commissaire Soneri traverse un phase de mélancolie profonde. Comme chaque année, à l'approche des fêtes, il repense à son épouse, Ada, décédée bien trop jeune dans des conditions tragiques. C'est alors qu'une vieille dame vient signaler la disparition de sa voisine, Ghitta. Cette dernière, Soneri la connait bien, c'était la propriétaire de la pension pour étudiants où logeait Ada lorsqu'elle fréquentait l'Université de Parme. C'est dans la pension de la via Saffi que Soneri et Ada se retrouvaient, entourés d'autres jeunes, pour refaire le monde et bâtir des projets pour leur avenir. Ghitta était un peu comme une deuxième maman pour tous ces jeunes venus de la campagne étudier en ville. Ghitta n'a pas disparu, elle a été assassinée, sauvagemment. Qui pouvait bien en vouloir à cette gentille vieille dame ? Soneri se replonge avec douleurs dans le passé et découvre alors que Ghitta avait aussi un autre visage, bien plus sombre ! Obligé d'arpenter à nouveau son ancien quartier, le commissaire mesure les changements survenus à Parme comme dans toute l'Italie, et pose un nouveau regard sur son propre passé.
La pension de la via Saffi est un roman policier avec un commissaire, un crime, des suspects... Mais c'est avant tout un magnifique roman d'ambiance au coeur d'un quartier populaire de Parme. Tout commence quelques jours avant Noël. Le commissaire Soneri traverse un phase de mélancolie profonde. Comme chaque année, à l'approche des fêtes, il repense à son épouse, Ada, décédée bien trop jeune dans des conditions tragiques. C'est alors qu'une vieille dame vient signaler la disparition de sa voisine, Ghitta. Cette dernière, Soneri la connait bien, c'était la propriétaire de la pension pour étudiants où logeait Ada lorsqu'elle fréquentait l'Université de Parme. C'est dans la pension de la via Saffi que Soneri et Ada se retrouvaient, entourés d'autres jeunes, pour refaire le monde et bâtir des projets pour leur avenir. Ghitta était un peu comme une deuxième maman pour tous ces jeunes venus de la campagne étudier en ville. Ghitta n'a pas disparu, elle a été assassinée, sauvagemment. Qui pouvait bien en vouloir à cette gentille vieille dame ? Soneri se replonge avec douleurs dans le passé et découvre alors que Ghitta avait aussi un autre visage, bien plus sombre ! Obligé d'arpenter à nouveau son ancien quartier, le commissaire mesure les changements survenus à Parme comme dans toute l'Italie, et pose un nouveau regard sur son propre passé.