 Le livre de Luigi Pintor retrace son parcours de vie : l'expérience de la guerre, les désillusions d'après-guerre, son engagement. En quelques mots, il tire les conclusions d'une vie, de la Sardaigne à Rome, au sud de l'Italie, une vie avec ses pertes, la mort d'un frère, la maladie et la mort de sa femme et ses combats, son engagement au PCI, la création du journal Il Manifesto...
Le livre de Luigi Pintor retrace son parcours de vie : l'expérience de la guerre, les désillusions d'après-guerre, son engagement. En quelques mots, il tire les conclusions d'une vie, de la Sardaigne à Rome, au sud de l'Italie, une vie avec ses pertes, la mort d'un frère, la maladie et la mort de sa femme et ses combats, son engagement au PCI, la création du journal Il Manifesto...
"L'engagement n'est pas une distinction qui sépare du commun des hommes, il est plutôt l'aimant qui attire, dans un champ de cohérence, les intentions éparpillées des vies humaines ; toutefois ces fragments s'ordonnent par leur fragilité et par leur fragilité se dispersent."
Tout en retrait mais avec force et détermination Luigi Pintor nous parle d'amour et de fraternité.
"A force de chercher la vérité parmi les nébuleuses célestes et de tracer des figures avec des équerres et des compas, on ne voit plus les choses simples que l'on a sous les yeux."
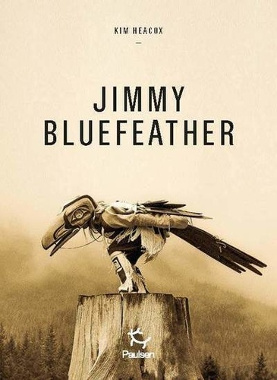 Keb Wisting vit à Jinkaat, petit village du sud-est de l'Alaska. Mi Tlinglit, mi Norvégien, Keb a été initié aux traditions des ces ancêtres indiens par son oncle Austin qui lui a appris à sculpter le bois, à naviguer, à pêcher, à reconnaître les animaux totems. A près de nonante-cinq-ans, il se souvient avec nostalgie de sa jeunesse alors que les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus aux connaissances de leur peuple, préférant ingurgité des litres de sodas devant la télé. Keb s'interroge sur ce qu'il fait encore dans ce monde alors que la plupart de ses amis et de trop nombreux membres de sa famille l'ont quitté. Chaque jour il attend, serein, que la mort vienne le chercher. Mais un événement va venir bouleverser le quotidien du vieil homme. L'un de ses petits-fils, James, dix-sept ans, est victime d'un accident qui le fera boiter à jamais. Or l'adolescent était promis à une brillante carrière dans une équipe professionnelle de basket. Une chance exceptionnelle d'atteindre la gloire et la richesse qui faisait bien des envieux à Jinklaat. Lorsque Keb entend James dire que sa vie est foutue et qu'il aurait mieux fait de mourrir, le vieil homme se révolte. Non, petit, ta vie n'est pas finie, tu as deux mains pour travailler, des yeux pour voir la beauté du monde, une famille et des amis autour de toi ! Keb décide alors d'apprendre à James à sculpter un canoë traditionnel. Une manière d'occuper ses mains et son esprit et de lui raconter les racines du peuple Tlingit. Très vite tout le village se joint à eux et ce retour aux sources devient un événement social où chacun vient apporter sa petite pierre. C'est toute une communauté qui est maintenant bien décidée à réaliser le rêve du vieil homme et de son petit-fils, rejoindre avec leur canoë Cristal Bay, la terre natale de Keb devenue une réserve naturelle interdite. Un roman peuplé de personnages attachants, de chaleur humaine et de paysages sauvages.
Keb Wisting vit à Jinkaat, petit village du sud-est de l'Alaska. Mi Tlinglit, mi Norvégien, Keb a été initié aux traditions des ces ancêtres indiens par son oncle Austin qui lui a appris à sculpter le bois, à naviguer, à pêcher, à reconnaître les animaux totems. A près de nonante-cinq-ans, il se souvient avec nostalgie de sa jeunesse alors que les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus aux connaissances de leur peuple, préférant ingurgité des litres de sodas devant la télé. Keb s'interroge sur ce qu'il fait encore dans ce monde alors que la plupart de ses amis et de trop nombreux membres de sa famille l'ont quitté. Chaque jour il attend, serein, que la mort vienne le chercher. Mais un événement va venir bouleverser le quotidien du vieil homme. L'un de ses petits-fils, James, dix-sept ans, est victime d'un accident qui le fera boiter à jamais. Or l'adolescent était promis à une brillante carrière dans une équipe professionnelle de basket. Une chance exceptionnelle d'atteindre la gloire et la richesse qui faisait bien des envieux à Jinklaat. Lorsque Keb entend James dire que sa vie est foutue et qu'il aurait mieux fait de mourrir, le vieil homme se révolte. Non, petit, ta vie n'est pas finie, tu as deux mains pour travailler, des yeux pour voir la beauté du monde, une famille et des amis autour de toi ! Keb décide alors d'apprendre à James à sculpter un canoë traditionnel. Une manière d'occuper ses mains et son esprit et de lui raconter les racines du peuple Tlingit. Très vite tout le village se joint à eux et ce retour aux sources devient un événement social où chacun vient apporter sa petite pierre. C'est toute une communauté qui est maintenant bien décidée à réaliser le rêve du vieil homme et de son petit-fils, rejoindre avec leur canoë Cristal Bay, la terre natale de Keb devenue une réserve naturelle interdite. Un roman peuplé de personnages attachants, de chaleur humaine et de paysages sauvages.
 A Honefoss, une petite ville de Norvège, le policier Lars Lukassen enquête sur le meurtre d'un ancien camarade de classe. Sa femme l'a quitté il y a un an et les discussions sont toujours vives au sujet de la garde de leur petite fille Annie.
A Honefoss, une petite ville de Norvège, le policier Lars Lukassen enquête sur le meurtre d'un ancien camarade de classe. Sa femme l'a quitté il y a un an et les discussions sont toujours vives au sujet de la garde de leur petite fille Annie.
Un homme rôde autour de l'école primaire. Il attire l'un ou l'autre enfant et lui raconte des histoires horribles.
Johanna, une jeune enseignante, rejoint l'école d'Annie. Elle est fort perturbée et angoissée. Elle a toujours peur, se sent suivie. Elle cache visiblement un passé fort douloureux.
La vertu du mensonge est une lecture totalement addictive. A la manière d'une très bonne série norvégienne, elle vous fera passer des nuits blanches...
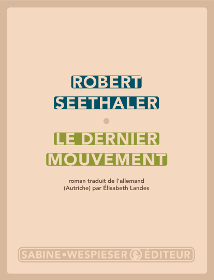 Ce court et limpide roman s'ouvre sur l'image de Gustav Mahler, souffrant de fièvre, enroulé dans une couverture, sur le pont avant du paquebot qui le ramène de New York, fixant la mer grise, puis laissant de plus en plus son esprit dériver sur ses souvenirs et pensées, sur la musique, le talent, l'amour, la mort... sur ce qui fait le coeur sensible d'une existence. Au fil de ce moment de solitude, passé devant l'océan, rafraichi par le vent, entrecoupé de quelques paroles avec le jeune garçon de cabine, Mahler se souvient des étés à la montagne voués à la composition, de ses difficultés à diriger l'orchestre de Vienne à la hauteur de ses exigences, de son amour pour Alma, de la perte de sa fille. C'est une vie marquée par la ferveur, qui voit sa fin approcher.
Ce court et limpide roman s'ouvre sur l'image de Gustav Mahler, souffrant de fièvre, enroulé dans une couverture, sur le pont avant du paquebot qui le ramène de New York, fixant la mer grise, puis laissant de plus en plus son esprit dériver sur ses souvenirs et pensées, sur la musique, le talent, l'amour, la mort... sur ce qui fait le coeur sensible d'une existence. Au fil de ce moment de solitude, passé devant l'océan, rafraichi par le vent, entrecoupé de quelques paroles avec le jeune garçon de cabine, Mahler se souvient des étés à la montagne voués à la composition, de ses difficultés à diriger l'orchestre de Vienne à la hauteur de ses exigences, de son amour pour Alma, de la perte de sa fille. C'est une vie marquée par la ferveur, qui voit sa fin approcher.
Bref, condensé, Le dernier mouvement ne perd pourtant rien en richesses, tant chaque image et sensation fait sens et porte sur le monde un regard apparemment simple, mais profond et sensible.