Keith McCafferty
Traduit de l'anglais (usa) par Marc Boulet
Editeur : Gallmeister Réserver ou commander
 Quel plaisir de retrouver une nouvelle aventure de Sean Stranahan, aquarelliste, guide de pêche à la truite sur la Madison, détective privé et amoureux inconditionnel du Montana ! Une femme qui s’était égarée en montagne lors d’une tempête de neige est retrouvée morte dans la tanière d’un ours. Un étui à mouches ancien, portant les initiales EH, est découvert dans le sac de la victime. EH, ne serait-ce pas Ernest Hemingway, le célèbre écrivain passionné de pêche ? Sean et ses amis du "Club des menteurs et monteurs de mouches de la Madison", partent sur les traces d’une malle perdue par l’auteur dans les années 30. Une enquête palpitante dans un décor grandiose.
Quel plaisir de retrouver une nouvelle aventure de Sean Stranahan, aquarelliste, guide de pêche à la truite sur la Madison, détective privé et amoureux inconditionnel du Montana ! Une femme qui s’était égarée en montagne lors d’une tempête de neige est retrouvée morte dans la tanière d’un ours. Un étui à mouches ancien, portant les initiales EH, est découvert dans le sac de la victime. EH, ne serait-ce pas Ernest Hemingway, le célèbre écrivain passionné de pêche ? Sean et ses amis du "Club des menteurs et monteurs de mouches de la Madison", partent sur les traces d’une malle perdue par l’auteur dans les années 30. Une enquête palpitante dans un décor grandiose.
Jason Roberts
Traduit de l'anglais par Jean-Yves Cotté
Editeur : Paulsen Réserver ou commander
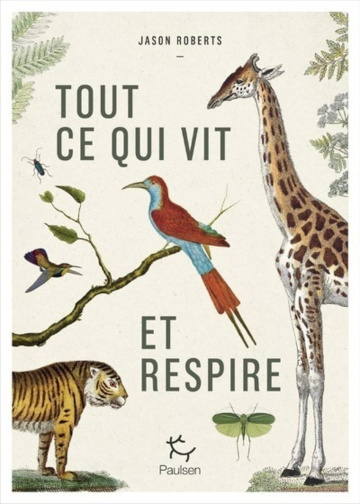 Tout les opposait et pourtant ils œuvraient à la même entreprise : identifier, décrire, classer, comprendre tout ce qui vit et respire ! Linné et Buffon, ces deux grands naturalistes qui ont traversé la majeure partie du XVIIIe siècle, ont laissé chacun un héritage déterminant pour l’histoire des sciences du vivant. Jason Roberts nous raconte les vies passionnantes de ces deux hommes remarquables qui se détestaient et se critiquaient par publications interposées mais qui se passionnaient pour l’étude minutieuse de la nature malgré les difficultés de leur époque. Prix Pulitzer de la biographie 2025, ce récit mêlant histoire, exploration, et sciences se dévore comme un grand roman d’aventures !
Tout les opposait et pourtant ils œuvraient à la même entreprise : identifier, décrire, classer, comprendre tout ce qui vit et respire ! Linné et Buffon, ces deux grands naturalistes qui ont traversé la majeure partie du XVIIIe siècle, ont laissé chacun un héritage déterminant pour l’histoire des sciences du vivant. Jason Roberts nous raconte les vies passionnantes de ces deux hommes remarquables qui se détestaient et se critiquaient par publications interposées mais qui se passionnaient pour l’étude minutieuse de la nature malgré les difficultés de leur époque. Prix Pulitzer de la biographie 2025, ce récit mêlant histoire, exploration, et sciences se dévore comme un grand roman d’aventures !
Adrien Bosc
Editeur : Stock Réserver ou commander
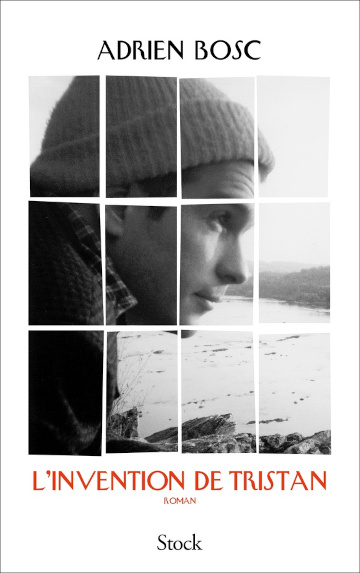 « L’invention de Tristan » d’Adrien Bosc retrace la vie d’un écrivain comète, Tristan Egolf. Une vie fulgurante à laquelle il mit fin à l’âge de 33 ans. Auparavant, il y aura eu une enfance en Pennsylvanie, un père fantôme et dangereux, une âme orageuse, des bouillonnements, Paris, l’écriture, un manuscrit perdu, le travail, la peine, une rencontre décisive avec une jeune femme. Un roman, « Le seigneur des porcheries », fleuve de mots et de fureur, de désordre et d’inventions, grand livre doté de mille vies et de mille plaies quand bien même il n’était que cahier noirci.
« L’invention de Tristan » d’Adrien Bosc retrace la vie d’un écrivain comète, Tristan Egolf. Une vie fulgurante à laquelle il mit fin à l’âge de 33 ans. Auparavant, il y aura eu une enfance en Pennsylvanie, un père fantôme et dangereux, une âme orageuse, des bouillonnements, Paris, l’écriture, un manuscrit perdu, le travail, la peine, une rencontre décisive avec une jeune femme. Un roman, « Le seigneur des porcheries », fleuve de mots et de fureur, de désordre et d’inventions, grand livre doté de mille vies et de mille plaies quand bien même il n’était que cahier noirci.
C’est le temps où se bâtira la légende, un halo que le livre s’évertue à la fois de respecter et de disperser pour approcher au plus près l’écrivain et l’oeuvre.
C’est un livre aussi passionnant qu’habile (narrateur, construction, chronologie) parce qu’il ne se contente pas de parler de la légende Egolf, il réfléchit également au texte en train de s’écrire. Il y a d’abord le choix du narrateur, Zachary, jeune journaliste au New-Yorker, qui, par désarroi personnel, se lance dans la quête Egolf en nous livrant au fur et à mesure du livre et de son apprentissage du métier, plusieurs portraits d’Egolf. Zachary rembobine sans cesse, trouve des angles et de l’amplitude à son article. Comme les cercles concentriques d’une série de ricochets - autour d’un même nom, d’un même temps ou d’un même espace, le livre bouge et vibre, et se déplace sans cesse dans le temps pour ménager la place la plus juste à son sujet et respecter au plus près la parole de ceux qui ont côtoyé l’écrivain. Le roman noue dans ses phrases les lumières, les clairs-obscurs, les chagrins, les paroles et les silences des uns ou des autres (les pages consacrées au couple d’amis d’Egolf, James et Shelly sont magnifiques tant leurs paroles sont vives et déchirantes)
Dans le geste littéraire, que sont la sincérité et l’intégrité ? Questions que se posent Zachary et il me semble avec lui, l’auteur lui-même. Car Adrien Bosc nous livre aussi ici une véritable profession de foi envers le journalisme littéraire.
Le rythme, l’éthique, la vérité. Et le hasard, et la fiction. Un entrelacs de signes et de lignes. Coup de coeur.
Samantha Hunt
Traduit de l'anglais (usa) par alex Ratcharge
Editeur : Le Gospel Réserver ou commander
 Tout au nord d’une Amérique au bord du gouffre, dans une petite ville de pêcheur qui ploie sous le ravage de l’alcoolisme, une jeune femme est amoureuse d’un vétéran de la guerre en Irak, beaucoup plus âgé qu’elle. Elle attend son père qui semble avoir disparu en mer il y a onze ans et… est persuadée d’être une sirène.
Tout au nord d’une Amérique au bord du gouffre, dans une petite ville de pêcheur qui ploie sous le ravage de l’alcoolisme, une jeune femme est amoureuse d’un vétéran de la guerre en Irak, beaucoup plus âgé qu’elle. Elle attend son père qui semble avoir disparu en mer il y a onze ans et… est persuadée d’être une sirène.
Grande beauté que ce premier roman de Samantha Hunt (publié en 2018 aux Etats-Unis ), tout le livre se tient sur un entre-deux entre conte et roman, légende et réel, une tonalité qui rend le livre proprement singulier. La narratrice raconte et c’est justement dans sa manière de dire que l’envoûtement agit et nous interroge, passant d’une pensée à une autre, tourbillonnant entre les images, entre le solide des mots et leur évaporation dans l’air. La jeune femme est obsédée par l’eau, et le bleu (et on saisit alors pourquoi Maggie Nelson en a fait la postface - brillante-). Il y a de magnifiques pages consacrées au brouillard, à la vapeur, aux gouttes, aux larmes et tout un art du lexique et de la métaphore pour mieux parler du désir, de l’absence et du manque. « Seul l’océan pour me sauver » parle si bien de la fascination (pour l’océan, pour un homme, pour un père, pour l’étymologie, pour un amour ou un souvenir) et d’un sentiment, en tout point énigmatique, celui de se sentir en totale altérité face au monde et au réel. Et c’est le lecteur qui doute - que raconte-t-elle cette fille si seule et si désirante, est-elle folle ? Peut-on la croire ? Et c’est précisément dans cet interstice que réside la beauté du roman. Samantha Hunt, réussit également, dans ce bruissement poétique et infini à livrer de très belles pages consacrées à Jude, le vétéran, plongé dans le terrible de la guerre en Irak. À mesure qu’il raconte (et ce que le soldat raconte, c’est une femme qui l’écrit - ça change tout), Jude fond littéralement devant son amoureuse : c’est un passage unique et magnifique. Des trouvailles comme celle-là, il y en a beaucoup, qui affolent et enchantent tant la matière et les images semblent inédites.